PERSONNAGES
par ordre alphabétique
C'est pendant son mandat d'évêque de Strasbourg que débuta la construction de l'église en l’an de grâce 1352 (voir la rubrique évènements).
Né le 20/10/1875 à Benfeld et décédé le 08/02/1955 à 80 ans. En 1900, il est
appariteur, agent de police à Benfeld, puis en 1926 sergent municipal. Il
passait beaucoup de temps à compulser les archives de la ville. Il épouse à
Sélestat, le 07/10/1907, Marie GONDIER, née le 02/02/1880 à Colmar, décédée à
Benfeld le 15/10/1985 (à 105 ans), couturière. Ils
auront 4 enfants : Paul, Pierre, Marie Louise et Charles. Eugène fut fait
officier d'académie en 1948, par Yvon Bourges, alors sous-préfet de Erstein,
futur ministre des armées.
- "D'r
Stubehansel", pièce (1925).
- "Die Festung Benfeld"
- "Benfeld. Grosse une kleine
Geschichte" (parution posthume en 1987).

Né à Epfig le 20 septembre 1838 – décédé à Strasbourg le 5 mars 1890 à l'age de 51 ans.
Il fut ordonné prêtre le 20 décembre 1861. Après avoir enseigné au petit séminaire Saint-Louis, puis Saint-Étienne de Strasbourg, de 1860 à 1872, il administra successivement les paroisses d’Obenheim (1872-1875) et de Steige (1875-1883), avant d’être nommé recteur de Benfeld (1883-1890).
L'image de droite est la chapelle que le curé Nartz a fait ériger dans le cimetière de Benfeld pour ses parent, Conrad Nartz (1810-1887) et Louise née Meyer (1810-1890).
Oeuvres :
«La Frankenburg au XIe et XIIe siècle», Revue catholique d’Alsace, 1887
«Les pouvoirs publics et les communautés sous le régime féodal», Revue nouvelle d’Alsace-Lorraine du 1.5.1887.
Le Val de Villé. Études historiques, Strasbourg, 1887.
«Ein bischöfliches Städtchen in früheren Zeiten. Verwaltungsskizzen», Revue nouvelle d’Alsace-Lorraine, janvier-avril 1889.
«Die Unholdin», Revue catholique d’Alsace, 1889.
«Epfig», ibidem, 1911-1912.
Plusieurs études historiques conservées dans les archives paroissiales de Steige, dont un Livre des traditions.
(Source : A. Dubail, «Le curé Nartz, historien du Val de Villé», Annuaire de la Société d’histoire du Val de Villé, 1987, p.170-202.)
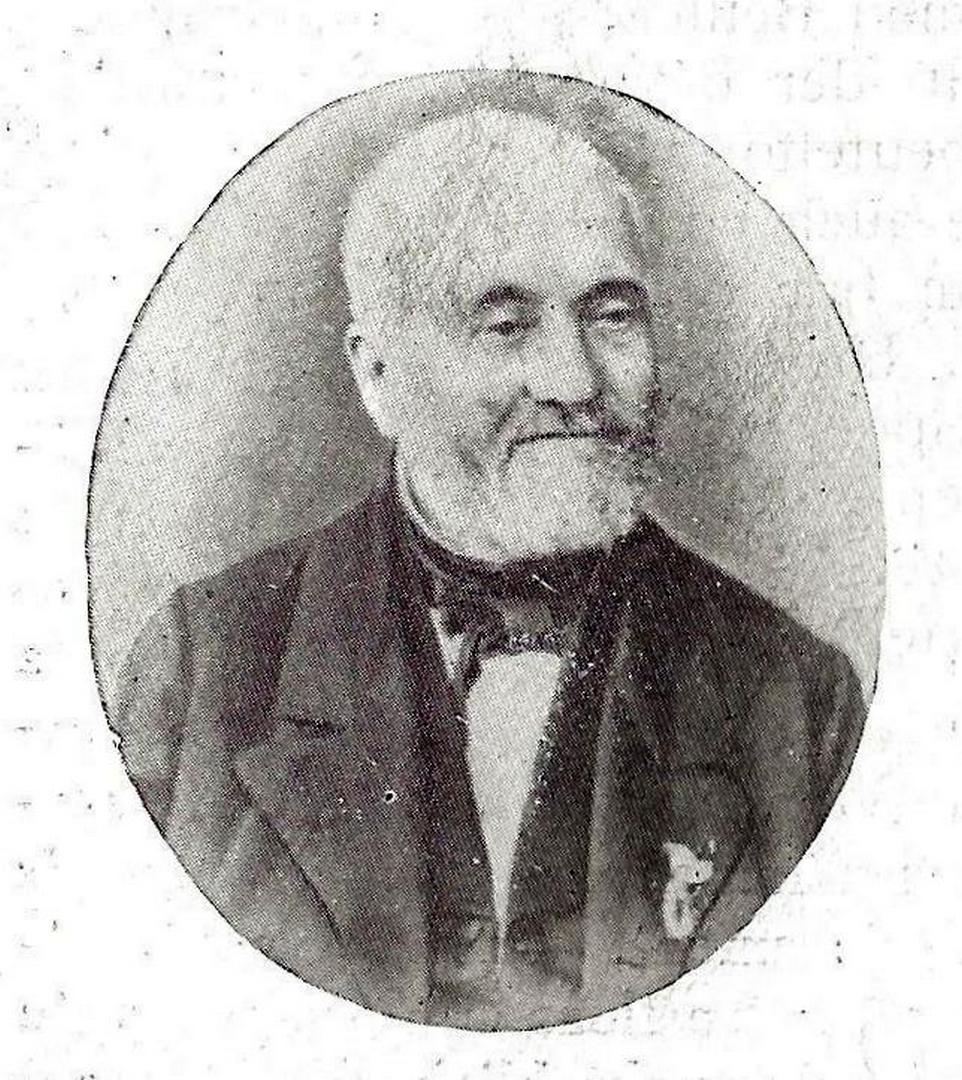
Le pharmacien, botaniste et
antiquaire Napoléon Nicklès, né à Erstein le 23 octobre 1808, a apporté une
contribution particulière aux antiquités d'Ehl ou d'Helvetum. Il était le fils
d'un secrétaire de la ville d’Erstein. Nickles s'installe à Benfeld en 1834 en
tant que pharmacien. C'était en grand amoureux de la nature et de l'antiquité
qu’il a contribué à l'histoire et à la science archéologique de l'Alsace et a
rendu de grand service grâce à ses nombreuses et inlassables recherches sur les
antiquités celtiques et romaines de sa patrie bien-aimée de Benfeld et d’Ehl.
Au fil du temps, le grand érudit avait rassemblé une vaste collection
d'antiquités : haches celtes et romaines, lances, pointes de flèches, clés et vaisselle
en faïence romaine. Nickles était également un érudit botaniste et
possédait un grand herbier de plus de 3000 plantes. Cet homme instruit et intelligent
mourut à Benfeld le 21 février 1878 à l'age de 70 ans.
Oeuvres :
1839 : Des prairies naturelles en Alsace et des moyens de les améliorer
1844 : Manuel populaire d’agriculture (trad. française de l’ouvrage de Schlipf, professeur à Hohenheim)
1856 : Le trèfle et son apôtre (Jean-Chrétien Schubart). Étude biographique, Colmar, 1856 et Revue d’Alsace 1856, p.433-443
1857 : Schwerz. Notice biographique, Colmar, s.d. et Revue d’Alsace, p.457-465
Lettre sur la culture du tabac et instruction sur cette culture (par
feu M. Huerstel), Société centrale d’agriculture de Nancy, Nancy, s.d.
1863 : Helvetus, Ehl près de Benfeld, s.d.; Helvetus au cinquième siècle, mémoire lu à la Sorbonne.
Pour la bibliothèque du cultivateur: le houblon, trad. française de l’ouvrage d’Erath
1864 : Helvetus et ses environs au cinquième siècle, Paris-Strasbourg
1864 : la terre végétale du Rieth français. Bulletin de la socièté d'histoire naturelle de Colmar 1863, 4eme année,135-143.
1865 : Le bain dit Holzbad, près de Westhausen, Strasbourg
1865 : «Deux exécutions à Benfeld», Revue d’Alsace, p.466-469
1866 : Das römische Ehl, Hohenburg und Hohengeroldseck, nebst den Sagen dieser Gegend, Mulhouse.
1866 : Das Spital von Benfeld und der alte Kirchturm daselbst, 1866.
1867 : Le moulin de Sand, 1867.
1869 : Rapport sur les excursions botaniques faites par le collège de Sélestat (excursions dirigées par Nicklès).
1877 : Coup d’œil sur la végétation de l’arrondissement de Schletstadt,
Colmar, 1877. 1ère partie. Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle
de Colmar, 1875/1876, 16ème et 17ème année : 168-239.
Emmuré dans la façade de l’ancien hôpital (Actuel Ehpad) se trouve la tombe du Baron Joseph Zénobie Reich de Platz, bailli du bailliage de Benfeld décédé le 11 janvier 1733. Dans son testament, il a souhaité, en signe d’humilité, être inhumé entre l’hôpital et l’église, dans le cimetière paroissial, afin que sa tombe puisse être foulée par tout un chacun. C’est le dernier de trois générations de Reich de Platz comme bailli du bailliage de Benfeld.
Son père François Ernest Reich de Platz (1660-1747) était grand veneur de l'évêché de Strasbourg et fut aussi bailli du bailliage de Benfeld. Il est décédé le 5 novembre 1747 à Benfeld.
Jean Werner Reich de Platz (1630-1685), le père de François Ernest obtint le titre de bailli du bailliage de Benfeld grâce à son amitié avec l’évêque de Strasbourg. Il a été immatriculé dans la noblesse de la basse Alsace en 1661. Il a acheté un bien immobilier à Still. Il a épousé Eve Félicité Zorn de Bulach dont le père était le précédent bailli de Benfeld.
Le père de Jean Werner, Henri Georges Reich de Platz (env. 1600-1640) était originaire du Tyrol et lieutenant-colonel d'un régiment Badois. Il s’installa en Alsace au début du XVIIe siècle.
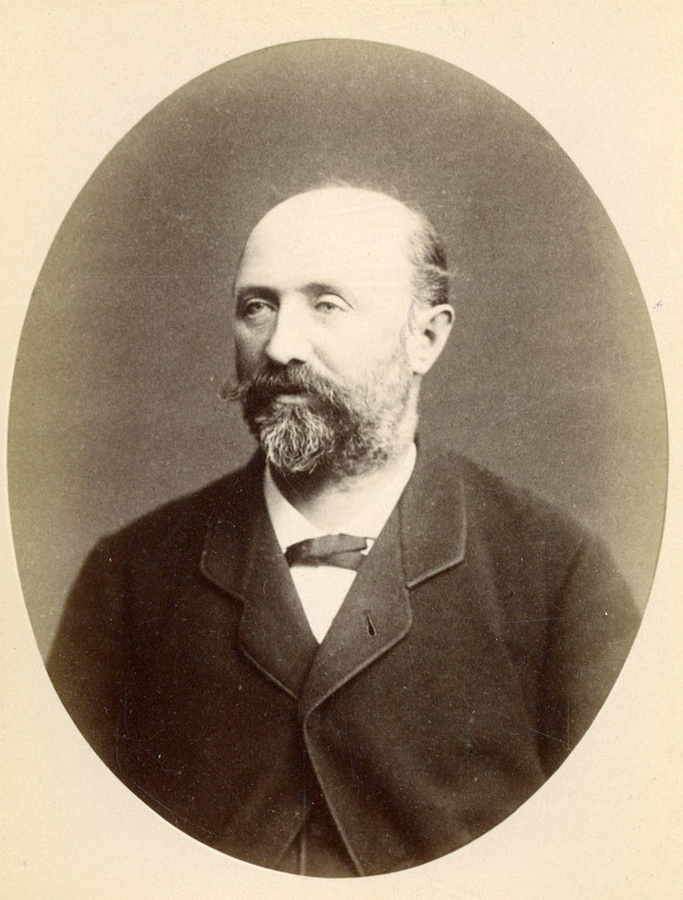
Né en 1837 à Marmoutier et mort à Benfeld en 1919 à l'age de 82 ans. Il compte certainement parmi les figures historiques les plus marquantes de l’histoire riche de notre cité. Quelques années après l’obtention de son doctorat de médecine en 1862 et une expérience à l’École de Médecine de Paris, il s’installe comme médecin à Benfeld.
En 1872, il fit construire un établissement de soins dans lequel il pratiquera l'hydrothérapie et l’électrothérapie destinées, selon ses propres termes, à certaines maladies musculaires, organiques, nerveuses ou cutanées.
Situé au bord de l’Ill dans un parc richement arboré, l’établissement proposait une cinquantaine de chambres confortables pour une patientèle aisée. Le parc fut un lieu de promenade et de quiétude, apprécié par les curistes qui pouvaient également s’adonner à des promenades en barque sur l’Ill et pratiquer ainsi une activité physique en complément de leurs soins. Benfeld devint ainsi une ville de cure, réputée pour la nature des soins innovants prodigués. La facilité d’accès par le chemin de fer, le dynamisme de la cité, le climat clément et le charme des bords de l’Ill furent des atouts également mis en avant par le Dr Sieffermann pour le choix de Benfeld.
Aujourd’hui, il ne subsiste de l’établissement qu’une passerelle métallique traversant l’Ill, située derrière la résidence des Jardins de l’Ill, là où se dressait l’établissement de cure qui fut fermé après la mort du docteur Sieffermann.
Médecin, il fut aussi un homme politique. En 1887, il est élu député au Reichstag de Berlin. Son action surtout protestataire s’inscrira dans le courant francophile de l’Alsace-Lorraine annexée. Toute sa vie, il fut un républicain convaincu, partisan d’un retour de l’Alsace à la France partageant les idées de son ami Georges Clémenceau qu’il rencontra au cours de leurs études de médecine. Tel fut Edouard Sieffermann ! Un homme aux activités plurielles pour le bien des autres. Homme de cœur, il fut aussi le médecin fidèle au serment d’Hippocrate soignant souvent les plus humbles et les miséreux.

Né le 30 juillet 1836 à Wettolsheim (Haut-Rhin) - Décèdé le 2 février 1918 à Ehl (Benfeld) à 82 ans.
Profession : Religieux, historien, enseignant et biographe
Édouard Sitzmann (Frère Édouard est le nom en religion d'Ignace Sitzmann), est un religieux, éducateur et historien alsacien, frère de la Doctrine chrétienne du diocèse de Strasbourg, directeur de l'Institut Saint-Materne d'Ehl et auteur notamment d'un ouvrage biographique de référence, le Dictionnaire de biographie des hommes célèbres de l'Alsace depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
Publications
1878 : Aperçu sur l'histoire politique et religieuse de l'Alsace : depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, Berger-Levrault, Paris, 1878, 181 p.,
1882 : (de) Geschichte des Dorfes Zillisheim, A. Sutter, Rixheim, 304 p.
1900 : Le château de Martinsbourg à Wettolsheim, Colmar,
1903 : « Une cité gallo-romaine ou Ehl, près Benfeld », in Revue catholique d'Alsace, 1903, 109 p.
1909-1910 : Dictionnaire de biographie des hommes célèbres de l'Alsace en deux tomes : depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, F. Sutter, Rixheim, ((VIII-874, 1105 p.), Prix Halphen de l'Académie française
1912 : « Un castel féodal : ou le château de Werde et ses propriétaires », in Revue catholique d'Alsace, 1912, 228 p.
1992 (rééd.) : le chanoine J. J. Eugène Mertian : fondateur de la Congrégation des frères de la doctrine chrétienne du diocèse de Strasbourg, Collège Saint-Joseph, Matzenheim, Frères de la doctrine chrétienne du diocèse de Strasbourg, 154 p.
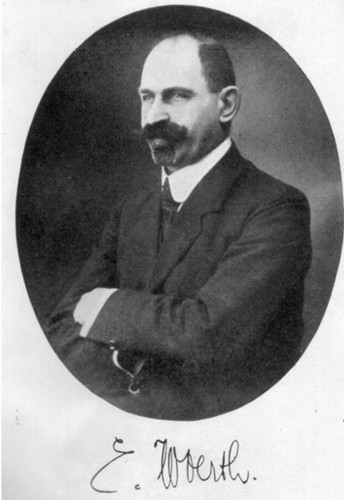
Né à Benfeld le 19 avril 1870 – décédé à Mulhouse en
1926 à 56 ans.
Parents : Aloise Woerth (né à Ehl), employé à Ehl (dans
la fabrique de chicorée Voelcker ?) et Marie-Anne Wackenheim.
En 1910, clerc de notaire de l’étude de maître Jules
Rohmer, propriétaire du châtelet.
A aussi travaillé longtemps comme représentant de
commerce.
Livres :
1897 : Auf Vogesenpfaden.
Gedichte.
1905 : die Stadt von Benfeld von 1592 bis 1632, histoires et
anecdotes
1906 : Klänge aus dem Sundgau : Gedichte/Neue Wanderlieder
1907 : Benfeld unter
schwedischer Herrschaft von 1632 bis 1650
1911 : Hoch und Allein, Gedichte und Lieder
1911 : l’hymne alsacien : le Elsässisches Fahnenlied (en allemand) ou Elsässisch Fàhnelied (en
alsacien) (littéralement le «Chant du drapeau alsacien) est l'ancien
hymne du Reichsland Elsaß-Lothringen. Il a été adopté en 1911 comme
hymne officiel de l'Alsace par le parlement d'Alsace jusqu’en 1918
(daye de la réintégration de l’Alsace et de la Lorraine). Ce chant fait
référence au drapeau Rot un Wiss également adopté par le parlement
d'Alsace. (source wikipédia)
1923 : Durch Gebirg und Tal. Erzählungen aus dem Elsass. Ephen,
Lieder und Gedichte
1926 : Zu Strassburg auf
der Schanz